La civilisation médiévale est une expression utilisée pour désigner la civilisation du Moyen Age, c'est-à-dire les moeurs et les façons de penser (la culture) dominantes des populations européennes durant le Moyen Age.
Le Moyen Age est le nom donné à toute la période comprise entre l'Antiquité (qui s'achève par convention en 476 : quand disparaît le dernier empereur romain régnant en Occident ) et l'ère moderne, laquelle commence avec la chute de l'empire romain d'Orient, en 1453. Les Turcs s'emparent en effet à cette date de Constantinople (rebaptisée plus tard : Istanbul) et la portée symbolique de l'événement est considérable. Quelques décennies plus tard, en 1492, la Reconquista s'achève en Espagne, dont Juifs et Musulmans sont expulsés en masse, et Colomb "découvre l'Amérique".
Extrait d'un film
"Le roman de Renart"
Cette adaptation est le premier film d'animation de
toute
l'histoire du Cinéma, réalisé en
France dans les
années trente.
Extrait du roman de Renart :
texte p 151
C'est
un livre mis en
forme à partir de 1170, l'un des tout premiers
livres
écrits en
Français, raison pour laquelle on le désigne
comme un "roman"
.
alors qu'il s'agit en fait d'un recueil assez disparate d'histoires
plus ou moins drôles (ou édifiantes) parodiant les
genres
littéraires à la mode au XIIème
Siècle.
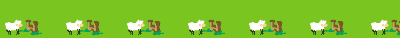 Une remise en
cause de la "pyramide féodale" et des pouvoirs seigneuriaux,
un désir de réforme
Une remise en
cause de la "pyramide féodale" et des pouvoirs seigneuriaux,
un désir de réforme
Intérêt
: La
période allant du XIème au XIIIème
Siècle est une ère
de changements très sensibles, durant laquelle les grandes
églises sont
désormais le plus souvent construites dans des villes.Les
agglomérations urbaines se développent et voient
se rassembler des communautés plus libres, celles
des "Francs" bourgeois organisés
en "communes" et affranchis de l'autorité
du seigneur ayant fondé la ville, ce dernier leur
accordant la Liberté dans le souci de favoriser
le commerce et de marquer le territoire de son empreinte
(bastides et villes franches)..
Or le roman de
Renart décrit exclusivement le monde
rural : les hommes et femmes
intervenant dans l'histoire sont des paysans, les animaux sont des
nobles ou des clercs. Il est probable qu'il adopte le point de vue des
citadins, hostiles à la féodalité,
soucieux que la Noblesse et l'Eglise purifient leurs moeurs donc se
réforment, mènent une vie plus conforme
à
l'Evangile...
Pour résumer, il semble que le roman recueille des
récits
traditionnels dénonçant les abus des puissants ;
il
est mis par
écrit au moment même ou les populations
citadines
s'organisent, et sans doute à leur intention.
Portée
: Le Roman de Renart fût un
succès
extraordinaire et exerça une influence durable sur la
culture
européenne (les Fables de La Fontaine, le cinéma
d'animation contemporain, etc.). Sa critique radicale de l'ordre
féodal a sans doute contribué à
accélérer les changements de mentalité
liés à l'essor des
Villes.
« LE TEMPS
DES CATHEDRALES » (Georges Duby)
DEUX
ASPECTS
DE LA
CIVILISATION MEDIEVALE :
PREPARATION DE LA LECON DU 23 JANVIER
CATHEDRALES
INTRODUCTION
Contextualisation et reformulation du sujet
Définition
préalable de
l’église cathédrale :
église d'une cité épiscopale, ville
chef-lieu d'un
diocèse, c'est-à-dire d'une province de l'Eglise
dirigée par un évêque.
L'évêque y
célèbre la messe et est assisté
de chanoines,
des prêtres vivant ensemble richement dotés et
formant une
communauté (ou
chapître) qui sont aussi des spécialistes du Droit Canon
(le droit de l'Eglise catholique) . Attention : des
chapîtres
(c'est-à-dire des assemblées de chanoines)
peuvent
desservir parfois d'autres églises que les
Cathédrales ;
on appelle ces églises particulières des
Collégiales. Dans tous les cas, les
évêques comme
les chanoines sont très riches et exercent une grande
autorité (Saint-Jean-de-Luz fût pendant des
siècles
la propriété du chapître de la
cathédrale de
Bayonne).
Interprétation du titre
: Du XIème au XIIIème Siècle, dans
l'Ouest de
l'Europe en tout cas, les églises cathédrales
prennent
une forme architecturale particulière et nouvelle : on en
bâtit des
dizaines, dans un style
dit "gothique" (alors qu'il s'agit plutôt d'un style
"Français" né dans le bassin parisien, entre
Seine et Rhin). Le titre fait donc référence
à
ce moment de l'Histoire médiévale, qui est aussi
une
époque d'unanimisme religieux. L'Eglise est alors la seule
institution universelle, elle
détient le monopole des
connaissances savantes et il est interdit - ou très
difficile -
de ne pas participer à ses cultes et de ne pas se soumettre
à ses lois (persécutions des Juifs, etc.). Les
villes
renaissent d'autre part, ce qui rend possible la concentration d'argent
et d'hommes nécessaires à des chantiers
qui
durent des décennnies, voire des Siècles !
La christianisation est
une expression qui peut évoquer : la conversion (celle des
païens notamment) aux principes de
la religion chrétienne (on parle plutôt, dans ce
sens, d'évangélisation)
mais aussi la diffusion de
valeurs et de moeurs
influencées par le Christianisme. Au
« temps
des cathédrales »,
l'Eglise s'efforce par exemple de
faire des guerriers des chevaliers, défendant la veuve et
l'orphelin et combattant le Mal (les infidèles) et
d'améliorer ses propres moeurs...
PREPARATION DE LA LECON DU 23 JANVIER
ROMAN DE RENART
En quoi le "Roman de Renart
"
nous donne-t-il des informations utiles pour comprendre
la
société féodale ?
Résumé de la vidéo : un rôle de justicier est imparti au roi, la défense de Renart lors de son procès montre que les nobles ont le droit de saisir les biens des paysans, les violences commises contre les païens ou mauvais chrétiens ne sont pas réprimées mais encouragées !
Nature et auteurs : un recueil écrit en langue romane (pas en Latin, mais en Vieux Français) et rédigé en vers, qui n'est donc pas, en fait, un "roman" au sens actuel de ce terme. Des histoires d'abord chantées ou récitées, d'origine septentrionales voire germaniques, mises par écrit par plusieurs écrivains anonymes dans la France du Nord à partir du XIIème Siècle, jusqu'au Lillois Jacquemars Giélée qui, en 1288, en propose une suite, intitulée "Renart le nouvel" (des compilations ou d'autres suites seront encore produites au XIVème Siècle). Une forme imitant celle des textes "à la mode" au Moyen Age (les Chansons de geste célébrant Roland et le temps de Charlemagne, ou les romans courtois fondés sur la matière de Bretagne, c'est-à-dire la légende du roi Arthur et de la Table Ronde, ou sur la matière de Rome - l'Antiquité). Une sorte de parodie de ces genres littéraires, écrite juste quand apparaît par ailleurs un genre nouveau : le roman de chevalerie en prose (Chrétien de Troyes).
Un récit parfois grossier, dont l'intention la plus évidente est la satire, centré sur un anti-héros, car le goupil n'est pas un aimable farceur mais un criminel malfaisant.
Une caricature de la société rurale médiévale ?
Contexte : la société du Moyen Age (dite féodale) est décrite dans la plupart des textes du XIème au XIIIème Siècles comme une société d'ordres. Idéalement, la population doit à cette époque se répartir conformément à la vision chrétienne de la société entre "ceux qui prient" ou oratores, "ceux qui combattent" ou bellatores et "ceux qui travaillent" ou laboratores. Cette organisation sociale est conforme aux conceptions de l'Eglise. Dans la Chrétienté, seul le clergé est, en effet, censé servir Dieu à plein temps, lui consacrant par exemple, comme les moines, cinq prières quotidiennes... tandis que les "laïcs" ont beaucoup moins d'obligations. Les soldats (ou milites) sont censés respecter les valeurs chrétiennes, donc défendre "la veuve et l'orphelin" mais aussi protéger l'Eglise, respecter les trêves qu'elle ordonne, etc... d'où l'effort des autorités Catholiques pour transformer les guerriers en "chevaliers". Les seigneurs ecclésiastiques et laïcs (possédant châteaux, abbayes, évêchés, etc.) sont unis entre eux par des liens vassaliques (hommages des vassaux à leur suzerain qui leur remet en contrepartie un fief). Le peuple travaille car il s'agit là d'une punition divine (Adam et Eve ayant été chassés du Paradis) et par conséquent d'un devoir moral pour tous les Chrétiens (les loisirs sont vus depuis Saint Augustin comme une détestable oisiveté, "mère de tous les vices").
Problématique : En quoi la remise en cause de la société féodale traditionnelle est-elle apparente dans le roman?
Pistes pour le développement : Le roman de Renart est en apparence fidèle à la conception ternaire de la société (des paysans, humains, travaillent la terre, et des animaux figurent le Clergé et les barons, membres de la Noblesse) mais il n'hésite pourtant pas à décrire des chevaliers tout à la fois voleurs et criminels (puisque Renart lui même, un châtelain - sire de Maupertuis, a violé la louve, sa parente, et commet les délits les plus divers) comme il se moque aussi des ecclésiastiques, et de la justice du Roi... voire du monarque lui-même.
L'oeuvre est donc, sous prétexte de plaisanterie, une critique très féroce de la société féodale, dont on suppose d'ailleurs qu'elle a d'abord été surtout lue par... les habitants des villes !
Ceux-ci commencent en effet, entre le XIème et le XIIIème Siècle, période de progrès économique et de réforme, à s'affranchir des contraintes que les Seigneurs et l'Eglise
imposaient au peuple au début du Moyen Age. Ils tendent à constituer un quatrième ordre dans la mesure où, contrairement aux habitants des campagnes, ils sont assez riches et nombreux pour résister aux seigneurs.
Personnages : si Noble le Lion est le contraire du Roi idéal - car il n'est nullement un juge impartial et avisé et va jusqu'à nommer Renart ministre ! il a peu à voir avec les rois régnant effectivement à cette époque, où la monarchie française renforce son autorité... La Reine Fière est frivole et oublie ses devoirs, tout au contraire de ce que l'on attend d'une demoiselle de haute lignée, telle que Blanche de Castille, laquelle gouverne la France avec sagesse et séduit les aristocrates sans pour autant leur accorder ses faveurs. Renart est l'antithèse du Chevalier, guerrier chrétien du Moyen Age : il part en croisade pour échapper au juste châtiment de ses crimes... Il est vrai qu'à l'époque bien des seigneurs (les Lusignan, des aventuriers tels que Gauthier de Chatillon, etc.) ont gagné la Terre Sainte pour s'enrichir et non pour délivrer le Tombeau du Christ, et que les croisés commettent de nombreux excès (pillages et violences de toutes sortes, contre les Juifs notamment, et de manière générale aux dépens des populations civiles dans les régions qu'ils traversent)..



