Jeudi 8
octobre
[13
h 10 - 15 h]
[Trace écrite du
08/10]
CHAPITRE
II
Semaine 41
Manuel
p 90 à p 95
Vocabulaire : un mouvement, une dynamique
RAPPEL -
Liste des
notions à maîtriser :
La Mondialisation
comme processus d’unification du monde
Les mouvements :
terme désignant des flux ou de manière
plus appropriée des changements structurels
Prépondérance
anglo-saxonne sur la Banque (Londres) et les bourses (New York)
Désindustrialisation
relative du Nord
Puissances
ascendantes
Intégration et
OMC
Stratégie
globale des entreprises
Triade
Géographie
ternaire
Pavage
fondamental
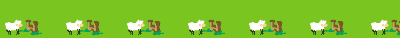
Aucun
absent
|
premier
trimestre du 4
septembre au 27 novembre
LA
MONDIALISATION EN MOUVEMENT :
SES DYNAMIQUES
FINANCIERE ET INDUSTRIELLE,
HISTORIQUE ET COMMERCIALE…
Reformulation du sujet et
problématisations.
Présentation de la
démarche : trois parties.
1°) La
mondialisation en fonctionnement :
un produit emblématique, le
processus et les acteurs, les débats.
2°)
Des
territoires
reliés et
hiérarchisés :
les synapses (étude de cas : une
ville mondiale)
; les centres et les
périphéries.
3°)
Lecture géostratégique des espaces maritimes
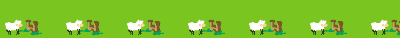
CARTE :
Le téléphone mobile, un produit
mondialisé

1. Les acteurs
de la mondialisation (étude de cas : le
téléphone mobile)
Analyse
géographique : qui fait quoi dans la
mondialisation ?

|
Jeudi 15
octobre
[13
h 10 - 15 h]
Surveillance
assurée par
la
Vie Scolaire
(le professeur encadrant une sortie en Littérature et
Société)
|
DEVOIR SURVEILLE n°1 -
DS1HG
Trois
absents
VACANCES D'AUTOMNE DU 16
OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE
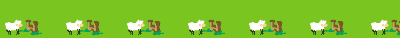
|
Mardi 3
novembre
[9
h 25 - 10 h 20] |
RECHERCHE SUR INTERNET
LA STRATEGIE
GLOBALE DES FIRMES Motorola et Blackberry |
Jeudi 5
novembre
[13
h 10 - 15 h]
Semaine
45
[Résumé de la
leçon du 05/11]
La
Téléphonie est un secteur où l'on
observe les
mêmes tendances que dans l'industrie en
général.
Ces tendances sont décrites ci-contre (avec des exemples
pris
dans le secteur automobile). Pour ce qui concerne le mobile et le
smartphone, l'étude de cas suivante sera faite par les
élèves eux-mêmes
(TP1G)
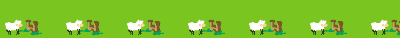 POUR
LE 19 NOVEMBRE
TP
1G
Diffusion du
CAHIER DE
REVISION n°1
(premier cahier)
POUR
LE 19 NOVEMBRE
TP
1G
Diffusion du
CAHIER DE
REVISION n°1
(premier cahier)
Pas de cours en Semaine 46
(participation du professeur à un séminaire
transnational) |
A -
Un bon exemple de la stratégie globale
des entreprises et de la nouvelle DIT
(Division Internationale du Travail)
DE
NOUVEAUX
ACTEURS
Les
multinationales, qui délocalisaient encore dans les
années 70 pour conquérir des marchés
extérieurs en créant des filiales dans des pays
tiers
plus ou moins fermés, pour y produire des biens
adaptés
aux besoins des locaux (VW ou Fiat au Brésil)
et procédaient surtout par l'injection d'investissements
directs
à l'étranger ou IDE sont devenues depuis les
années 80 des Transnationales (FTN) à l'instar de
Renault, société Française
à l'origine, devenue un groupe franco-nippon
après le rachat de Nissan, plus gros que son
propriétaire et dirigé
par
une personnalité Hispano-Libanaise (Carlos Ghosn).
Basée
au Pays-Bas sur le plan fiscal (son capital est
flottant, la firme a racheté des concurrents dans de
nombreux
états, son staff s'exprime en Anglais) Renault conserve ses
bureaux
d'étude et sa Direction centrale à Paris). En
règle générale, les FTN
ont délocalisé leurs sièges
(optimisation fiscale)
mais concentré leurs activités
stratégiques dans
des "quartiers généraux" (headquarters) ,
elles
internationalisent leur
management et leur actionnariat. Il peut s'agir de grosses entreprises
mais également de PME extravertie. Si elles
émettent
encore des IDE (surtout celles qui ont conservé des
activités de fabrication, à la recherche de pays
sûrs.. comme la France !) beaucoup délocalisent de
plus en
plus (le Sud profitant de la désindustrialisation du Nord)
en
externalisant leur production, c'est-à-dire en
sous-traitant des tâches auprès de fournisseurs
indépendants opérant dans des pays à
bas salaires.
Il s'agit pour les FTN, dorénavant, de fabriquer (ou de
faire
fabriquer) sur un site unique un produit standard
commercialisé
ensuite dans le monde entier, et identique pour tous les
marchés
: la Ford Mondeo a été le premier
modèle
automobile conçu dans cet esprit
Aucun absent
DE NOUVEAUX
RAPPORTS NORD-SUD
Film
: la
téléphonie mobile connaît un Boom en
Afrique,
d'après la chaîne de
télévision AL-Qarra
|
Jeudi 19
novembre
[13
h 10 - 15 h]
Semaine 47
[Résumé de la
leçon du 19/11]
Dans
le cas du téléphone, on note que les centres
de décision sont dans les pôles de la Triade
(Apple aux
Etats-Unis, Samsung en Corée, Nokia en Finlande, etc.), mais
encore que
la conception ainsi que la fabrication de quelques
éléments de très haute technologie
sont
également localisées en Europe, au Japon ou aux
Etats-Unis, tandis que l'assemblage
s'effectuant en Asie de
l'Est, essentiellement en Chine, le premier des pays
"émergents". Au total, les mobiles sont
produits en dehors du Nord (un groupe comme Alcatel n'est plus
fabricant ni même vendeur de mobiles) et sur un nombre
très restreint de sites industriels ; cette
"rationalisation"
souligne l'interdépendance des différents
secteurs
géographiques de l'espace mondialisé car elle
rend la
filière vulnérable (il en va de
même, pour
l'informatique, car la totalité des ordinateurs portables
est
fabriquée dans le delta de la Rivière des Perles,
et la
plupart des barrettes de mémoire le sont en
Thaïlande...)
|
B - Des flux
intégrateurs
CORRECTION TP1
Interrogation
orale et correction de la première question : le
Mali est un PMA pour lequel le mobile représente une
opportunité de développement. Son territoire peut
faire
figure "d'angle mort" sans que la prédation des richesses
nationales soit empêchée ; l'état
malien est
jugé "défaillant (intervention militaire
française
pour restaurer un gouvernement d'apparence démocratique et
qui
gouvernerait effectivement le "Nord" sécessioniste).
Le mobile permet de contourner l'enclavement du pays et de faire
accéder la population aux flux d'information
globalisés,
il évite des dépenses d'infrastructures
coûteuses -
pas de réseau filaire à mettre en oeuvre - tout
en
créant de l'activité - installation d'antennes
relais,
développement d'un marché local de la
téléphonie.
Plus généralement, c'est l'intensification des
échanges qui permet l'intégration plus ou moins
accomplie
des territoires.
DE NOUVEAUX
RAPPORTS NORD-SUD Du fait de la
"stratégie globale" mise en place par les firmes, qui
débouche sur la création d'un marché
unique
mondial, la division
internationale du travail traditionnelle, opposant les pays
industrialisés du Nord aux pays en développement
exportateurs de matières premières du Sud est
complètement obsolète. Le Nord perd des emplois
dans le
secteur secondaire (au profit d'une
tertiarisation périlleuse compte tenu que, dans le domaine
des
Services aussi, la concurrence des PVD est rude) et parmi les pays du
Sud, certains sont des grandes puissances industrielles
émergentes (notamment les BRICS) qui ont réussi
leur
remontée de filière (comme la corée du
Sud ou
Taiwan avant eux, qui ne sont plus considérées
comme "en
développement" mais sont membres de l'OCDE et vus comme des
pays développés).
DE NOUVELLES STRATEGIES TERRITORIALES La concurrence entre territoires
cherchant
à bénéficier des
délocalisations aboutit
à la recherche d'une "compétitivité",
plus grande
pour les zones franches (peu ou pas de taxes, comme dans les ZES
chinoises, celle de Shenzen par exemple) qui forment une ceinture
dorée à l'interface Nord-Sud (Tanger, Panama, Suez, etc.)
et pour les "hubs" (point
d'éclatement des trafics bien reliés au monde
entier,
comme le port de Singapour : d'une manière
générale, les FTN privilégient les
régions
où la main d'oeuvre est docile, qualifiée
et
abondante, et où les autorités se montrent peu
exigeantes
(Maquilladoras au Mexique, activités textiles au Bangladesh,
etc.). Exemptions de taxse, prise en charge publique du
coût des infrastructures et de la formation sont
utilisées pour stimuler le dévelopement
économique d'états et de territoires
infranatinaux soumis à la pression des décideurs
économiques.
Aucun absent
DEVOIR DE RATTRAPAGE POUR LES ABSENTS DU 15/10
Diffusion du CAHIER DE
REVISION n°1(second cahier)
|
COURS A RECOPIER ET
APPRENDRE POUR LE 10 JANVIER
EXERCICE TP 1G :
Expliquez en une ou deux
phrases chacune des expressions portées en gras
Pas de cours en Semaine 49
(absence du professeur, encadrant un voyage d'étude
à Rome)
SAISIE DES ABSENTS SUR PRONOTES : plus de mention dans ce cahier de textes
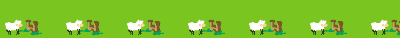
|
C - Une
mondialisation limitée et des
problèmes
Il
existe des résistances
culturelles
à certains usages du
mobile (interdit parfois la nuit dans certains pays, car il
favoriserait la débauche) : la société
et les
religions sont des acteurs, parfois des freins, dans le processus.
Le réseau est encore loin
d'être universel (l'intérieur de l'Afrique ou
même de
l'Indonésie sont encore largement des "angles morts") : la
pauvreté et/ou la défaillance des
états sont des entraves.
Des zones d'influence commerciales
empêchent une concurrence véritablement
ouverte Orange en position éminente dans les pays
africains
francophones). Le
marché unique mondial reste fragmenté.
Les états sont en outre sollicités par les
opérateurs et assument une part importante des
coûts en
matière d'infrastructures,
notamment dans les pays les plus démunis (Mauritanie), ce
qui
fait courir le risque d'une réexportation des profits
illustrant
une asymétrie désignée par une
formule, classique, celle de croissance sans
développement.
D'autant que la généralisation du
mobile peut créer une "bulle" de
prospérité dont on peut douter de la consistance
réelle (Haïti).
Les métaux précieux nécessaires
à sa
fabrication seraient en outre un facteur de déstabilisation
décisif au Congo-Kinsasha. La fabrication comme la
destruction
des appareils sont source de pollutions, le produit est ainsi
emblématique de la Société de
Consommation
(remplacement régulier encouragé par les
Opérateurs et les Constructeurs, obsolescence
programmée
des mobiles dont la durée de vie est très
limitée). Certaines
ONG et OIG dénoncent ces dérives...
la gouvernance globale n'est pas efficace. |
Jeudi 26
novembre
[13
h 10 - 15 h]
Semaine 48
[Résumé de la
leçon du 26/11]
UN CROQUIS
POUR DEUX DES SUJETS DE CARTOGRAPHIE POSSIBLES AU BACCALAUREAT
PAS DE COURS EN SEMAINE 49 (encadrement d'un Voyage d'étude
à l'étranger par le Professeur)
|
2. Les lieux de
la mondialisation : des territoires reliés par des
flux
A – Une
Géographie Ternaire
Un oubli sur la
carte : les centres montrés comme des angles morts faute
d'une couleur pour mettre le "Nord" en relief !
Le recours à une explication classique opposant Centre,
Périphérie (intégrée) et
Marge (ou
périphérie marginale).
Une conception concentrique voire ethnocentrique du monde (contestable
mais opérante).
La projection polaire, choisie dans la plupart des cas pour
représenter les flux.
B – Des
centres d'impulsion dispersés mais
étroitement reliés et formant un "village
planétaire" (les
pôles de la Triade et autres "îles de l'oligopole
géographique mondial" )
Un Centre polyforme : la
Triade, les mégalopoles, le réseau des
villes-mondes et l'archipel métropolitain.
C – Croquis : des
flux plus ou moins intégrateurs et des territoires plus ou
moins intégrés (CARTE n°1+2)
|
Jeudi 10 décembre
[13
h 10 - 15 h ]
Semaine 50
|
Croquis - suite
[Plan de la
leçon du 10/12]
3. Le pilotage et les limites de la mondialisation
reformulation
pilotage ou direction du processus de mondialisation : identification
des "décideurs" ; limites spatiales, résistances
culturelles et politiques
A - Un centre ?
le
Nord et la Triade ne s'identifie plus forcément au "centre" qui
est plutôt un "archipel métropolitain" constitué de
métropoles du Nord et du Sud, interconnectées... au coeur
de cette toile, des villes-mondes, dont la principale est : la "grosse
pomme"
Film : New York vue du ciel
|
Jeudi 17 décembre
[13
h 10 - 15 h ]
Semaine 51 |
CROQUIS
SCHEMATIQUE New York, une ville mondiale
INTERROGATION ECRITE
VACANCES DE FIN D'ANNEE DU 20 DECEMBRE AU 4 JANVIER |
Jeudi 7 janvier
[13
h 10 - 15 h ]
[Résumé de la
leçon du 07/01]
Semaine 1
Le
paradoxe : les frontières n'ont pas disparu dans l'espace
mondialisé, mais ont largement changé de nature
(interfaces). Elles sont devenues beaucoup perméables aux flux
économiques, alors que la libre circulatin des Hommes est
toujours remise en question
La
prolifération des frontières a été
liée à la décolonisation et à l'implosison
dumonde communsite : le nombre des états souverains augmentent,
celui des frontières aussi ! Le processus est inachevé..
|
B - Des clivages et des frontières qui prolifèrent paradoxalement : l'exemple des espaces maritimes
La
typologie des frontières devient complexe : on oppose les
interfaces aux frontières fermées (appelées
parfois "limes") et des frontières
maritimes
s'ajoutent aux frontières terrestres (extension de la
souveraineté des états, depuis la
Convention de Montego Bay, signée en 1982, bien au delà
des limites des eaux territoriales ;
les états riverains devenant propriétaires des ressources
économiques au large, s'ils le désirent).
Définition d'une ZEE
s'étendant initialement à 200 milles nautiques du rivage
soit environ 370 km calculés au delà de la zone
territoriale des 12 milles. Cette emprise est aujourd'hui parfois
définie, au libre choix des états,
soit d'après la ZEE soit d'après
le plateau
continental, jusqu'à 350 milles des côtes, au plus)
CARTE : GEOSTRATEGIE DES ESPACES OCEANIQUES
(sujet
de type Baccalauréat, carte n°3)
1 - L'enjeu océanique
2 - La littoralisation des activités
3 - Des menaces de toutes sortes
4 - Une absence de gouvernance globale et des tensions inquiétantes
La
dernière partie, voire les deux dernières, ne sont pas
indispensables dans la cadre de la production graphique exigible au
Baccalauréat
|
Jeudi 14 janvier
[13
h 10 - 15 h ]
Semaine 2 |
DEVOIR SURVEILLE n°2 - DS 2HG
Trois
sujets au choix : Faire l'une des deux compositions proposées (en
Histoire : sur les médias ; en Géographie : sur le
chapitre II) ou deux des trois épreuves courtes (un des trois croquis
sur la mondialisation ; une étude sur les médias dans la crise des
années 60 ; une étude sur la Mémoire de la seconde guerre mondiale)
|
Jeudi 28 janvier
[13
h 10 - 14 h 05]
[Plan de la
leçon du 28/01]
Pas de cours le 21 janvier
(participation du professeur à un événement organisé à Paris par l'Agence nationale Erasmus+)
Semaine 4
CONSIGNE : En quoi cette caricature rend-elle bien compte des
limites de la mondialisation et desdéfis à relever dans
le cadre d'une gouvernance globale ?
|
C - Une gouvernance problématique
critique et faillite de "l'Hyperpuissance", faiblesse de la "communauté internationale"
C1 Un exemple d'Etude Critique de Document
Comment l'un des principaux dessinateurs de
presse et illustrateurs susceptibles de voir leur oeuvre être choisie comme
sujets de Bac (Plantu, Chappatte, Singer...) représente le monde d'aujourd'hui
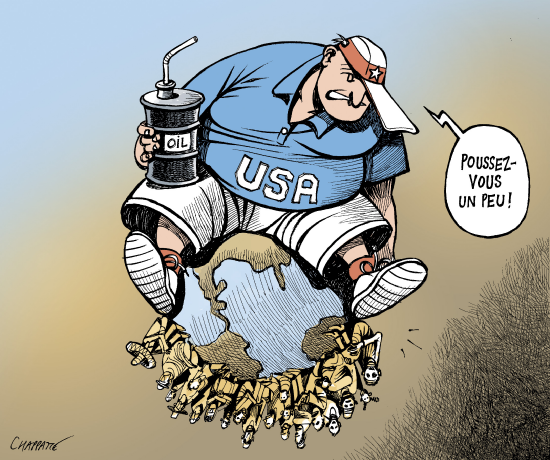 |
3°)
Certains effets de la mondialisation (que les économistes
libéraux présentent comme un phénomène
"heureux" favorisant la sortie du sous-développement voire le
triomphe de la Démocratie, tandis que les Socialistes affirment
la nécessité de la réguler voire d'adopter un
autre modèle dit "altermondialiste") font
particuliérement
débat : le développement économique et social
qu'elle provoque s'accompagne en effet de phénomènes d'exclusion
et
semble accroître les inégalités (y compris
spatiales) ; la poursuite indéfinie de ce processus de
développement semble compromise par l'épuisement
prévisible des ressources (d'où la recherche d'une
solution encore hyoothétique, le "développement durable")
;
enfin
l'uniformisation culturelle de l'espace mondialisé - qui
pourtant paraît très
superficielle - nourrit des formes de rejet violent de "l'Occident" (Islamisme radical, etc.).
|
C2 Eléments pour une
composition (ou le développement d'une étude critique de
document) sur les limites de la mondialisation
1°) La Mondialisation, quand elle fait débat, prend souvent la forme d'une contestation de l'hégémonie nord-américaine,
portée par des individus, des groupes ou des nations, qui
peuvent critiquer aussi bien la politique étrangère du
pays que son modèle de civilisation (libéralisme, capitalisme, consumérisme). Ce n'est pas tant
l'intensification des échanges que ses implications culturelles
ou sociales qui sont l'objet de critiques...
Pilotes de la
mondialisation depuis 1945, les Etats-Unis voient ainsi leur leadership contesté.
2°) Ce sont les états qui demeurent les
principaux acteurs des relations internationales et possèdent
seuls les moyens de s'opposer concrétement au processus de
mondialisation, perçu comme portant atteinte à leur
souveraineté ou à leurs intérêts
économpiques. La France a notamment, soutenue par l'UE,
imposé le principe d'une "exception culturelle" s'agissant des
échanges de musique, film, littérature... L'Iran ou le
Vénézuéla sont
coutumiers de la dénonciation de l'impérialisme des
Etats-Unis. On constate donc que la Mondialisation n'efface pas les frontières et n'élimine pas du jeu les états. Au contraire, la
pulvérisation du planisphère politique (1 p 178) se poursuit (le
"pavage fondamental" se complique malgré la remise en cause du
modèle stato-national, jugé dépassé par
certains). Pour autant, si les frontières sont plus nombreuses,
leur rôle évolue : ce sont des "interfaces" plus ou
moins actives en fonction du degré d'intégration dans
l'espace mondialisé : le Vénézuéla a pour
premier partenaire commercial... les Etats-Unis ! et l'Iran, sous
embargo, exporte malgré tout son pétrole (vers la Chine,
notamment).
|




 P-L Vanderplancke / cahier de textes du 8 octobre au 28 janvier
P-L Vanderplancke / cahier de textes du 8 octobre au 28 janvier